
Les Contes d'Hoffmann
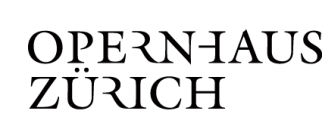
Le poète Hoffmann est déchiré entre l'art et la vie, l'amour et le fantasme, le rêve et la réalité. Son amour pour la chanteuse Stella reste sans réponse, et Hoffmann se réfugie dans l'alcool et ses mondes imaginaires. Au cours d'une soirée bien arrosée, il raconte à ses amis trois histoires d'amour fantastiques...
Dans son dernier opéra, Jacques Offenbach a fait de son personnage principal, E.T.A. Hoffmann, le poète le plus célèbre de la période romantique. Le poète explore de manière fascinante la frontière entre réalité et fantaisie dans ses contes magiques et surréalistes. L'opéra est une combinaison magistrale d'opérette, d’opéra-comique sentimental et d'opéra romantique fantastique. Des inventions mélodiques originales se mêlent à un drame captivant et l'ironie subtile d'Offenbach vient sans cesse contrarier les sentiments exaltés de son personnage principal. Offenbach a laissé son dernier opéra inachevé. Depuis la première posthume de 1881, différentes versions ont été publiées par divers éditeurs. L'Opéra de Zurich a choisi la version publiée par les deux éditeurs Michael Kaye et Jean-Christophe Keck. Mise en scène pour la première fois par Andreas Homoki en 2021 pendant la pandémie de coronavirus, la production zurichoise est enfin présentée au public à l'Opéra et en direct en ligne sur OperaVision. Après ses débuts réussis en 2021 dans le rôle-titre, Saimir Pirgu revient dans le rôle d'Hoffmann, sous la direction d'Antonino Fogliani à la tête du Philharmonia Zürich.
DISTRIBUTION
|
Hoffmann
|
Saimir Pirgu
|
|---|---|
|
La Muse / Nicklausse
|
Marina Viotti
|
|
Olympia
|
Katrina Galka
|
|
Antonia
|
Adriana Gonzalez
|
|
Giulietta
|
Lauren Fagan
|
|
Stella
|
Maria Stella Maurizi
|
|
Lindorf / Coppélius / Le docteur Miracle / Le capitaine Dapertutto
|
Andrew Foster-Williams
|
|
Andrès / Cochenille / Frantz / Pitichinaccio
|
Nathan Haller
|
|
Maître Luther
|
Valeriy Murga
|
|
Hermann
|
Steffan Lloyd Owen
|
|
Nathanaël
|
Christopher Willoughby
|
|
Wolfram
|
Maximilian Lawrie
|
|
Wilhelm / Le Capitaine des Sbires
|
Lobel Barun
|
|
Spalanzani
|
Daniel Norman
|
|
Crespel
|
Stanislav Vorobyov
|
|
La Voix de la tombe
|
Judith Schmid
|
|
Peter Schlémil
|
Samson Setu
|
|
Orchestre
|
Philharmonia Zürich
|
|
Chœurs
|
Chœur de l'Opéra de Zürich
|
| ... | |
|
Musique
|
Jacques Offenbach
|
|---|---|
|
Texte
|
Jules Paul Barbier
|
|
Mise en scène
|
Andreas Homoki
|
|
Direction musicale
|
Antonino Fogliani
|
|
Décors
|
Wolfgang Gussmann
|
|
Costumes
|
Wolfgang Gussmann
Susana Mendoza
|
|
Co-scénariste
|
Thomas Bruner
|
|
Conception d'éclairage
|
Franck Evin
|
|
Direction des chœurs
|
Janko Kastelic
|
|
Dramaturgie
|
Beate Breidenbach
|
| ... | |
VIDEOS
L’HISTOIRE
Acte I
La Muse souhaite reconquérir Hoffmann, tant pour elle-même que pour l'art. À cette fin, elle se fait passer pour l'étudiant Nicklausse afin de pouvoir accompagner Hoffmann dans ses aventures. Alors que Don Giovanni de Mozart est joué au théâtre voisin, un groupe d'étudiants se réunit pour passer une soirée de beuverie à la cave à vin de Luther. Ils sont rejoints par Hoffmann et Nicklausse. Hoffmann est tombé amoureux de Stella, qui chante le rôle de Donna Anna. La servante de Stella est censée apporter à Hoffmann une lettre contenant la clé de sa loge, mais Lindorf, qui convoite également la chanteuse, intercepte l'enveloppe dans le but de lui rendre visite lui-même. Hoffmann divertit tout le monde en chantant la ballade de Kleinzach. Mais ses pensées reviennent sans cesse vers Stella. Il finit par parler des trois femmes qu'il a connues dans sa vie.
Acte II
Dans la maison du physicien Spalanzani, Hoffmann rencontre la belle Olympia. Il choisit d'ignorer les remarques sarcastiques de Nicklausse qui dit qu'Olympia n'est qu'une poupée. Coppélius, marchand d'appareils optiques et d'yeux artificiels, se présente comme un ami de Spalanzani et vend au poète une paire de lunettes miracles, grâce auxquelles Hoffmann trouve effectivement la prestation d'Olympia encore plus séduisante. Il avoue ses sentiments à Olympia et interprète ses réponses monosyllabiques « oui, oui » comme des protestations passionnées d'amour. Au cours de la valse rapide qu'il danse ensuite avec Olympia, la poupée devient rapidement incontrôlable et Hoffmann perd ses lunettes. Entre-temps, Coppélius, qui a fabriqué les yeux d'Olympia, a découvert que le chèque avec lequel Spalanzani voulait le tromper n'avait aucune valeur. Furieux, il revient et détruit la poupée. Hoffmann se rend compte qu'il était amoureux d'un automate.
Acte III
Antonia, la fille du luthier Crespel, chante une chanson mélancolique. Son père lui interdit cependant de chanter, car elle risque sa vie : la mère d'Antonia, une chanteuse célèbre, est morte de la même maladie mystérieuse. Crespel recommande à son serviteur Frantz de ne laisser entrer personne dans la maison. Mais Frantz est dur d'oreille et, lorsque Hoffmann apparaît, il lui réserve un accueil chaleureux. Antonia et Hoffmann tombent dans les bras l'un de l'autre. Lorsque Crespel revient, Hoffmann se cache et observe le docteur Miracle qui examine Antonia. Crespel chasse Miracle de la maison, car il pense que ce mystérieux médecin est responsable de la mort de sa femme et qu'il tuera également Antonia. Hoffmann a maintenant appris qu'Antonia est condamnée à mourir si elle continue à chanter. Seul avec elle, il lui fait promettre de renoncer à sa carrière de chanteuse. À peine Hoffmann est-il parti que Miracle revient et décrit à Antonia la vie splendide d'une chanteuse. Antonia tente de résister à la tentation de toutes ses forces et de tenir sa promesse, mais lorsque sa mère décédée apparaît, elle se joint à son chant – et meurt.
Acte IV
Hoffmann a décidé de renoncer à tous ses sentiments romantiques et de ne se consacrer qu’aux plaisirs éphémères. Mais il rencontre alors la courtisane Giulietta, qui entretient des liens mystérieux avec le capitaine Dapertutto. Giulietta présente Hoffmann à ses autres invités, parmi lesquels se trouve Schlémil, qui est en possession de sa clé. Dapertutto ordonne à Giulietta de séduire Hoffmann et de lui demander de lui donner son reflet ; elle a déjà obtenu l'ombre de Schlémil pour Dapertutto de la même manière. Lorsque Giulietta hésite, Dapertutto raconte à la courtisane à quel point Hoffmann a parlé d'elle en mal. Giulietta accepte alors la demande de Dapertutto et réussit facilement à séduire Hoffmann. Afin de s'emparer de la clé de Giulietta, Hoffmann tue Schlémil en duel. La mort de Schlémil est découverte ; Hoffmann est contraint de fuir. Giulietta le supplie de lui confier au moins son ombre s'il doit la quitter. Hoffmann accepte, puis se rend compte que Giulietta l'a trompé.
Acte V
De retour dans la cave à vin, Hoffmann est arrivé à la fin de son récit, et la représentation de Don Giovanni est également terminée. Après son triomphe dans le rôle de Donna Anna, Stella a attendu Hoffmann en vain. Accompagnée de Lindorf, elle apparaît alors dans la cave à vin. Mais Hoffmann, ivre, se moque d'eux en chantant le dernier couplet de la ballade de Kleinzach. Lorsqu'il apprend que Stella lui a écrit une lettre qu'il n'a jamais reçue, Hoffmann est désespéré. Stella lui pardonnera-t-elle ?
EN PROFONDEUR
Le plaisir réside dans les situations inventées par Offenbach
Une interview avec le metteur en scène Andreas Homoki
Avant la première, le metteur en scène Andreas Homoki a évoqué le romantisme noir et les images chimériques des femmes dans cet opéra, les défis posés par la forme complexe et la virtuosité stylistique d'un compositeur rompu à toutes les ficelles du théâtre.
Au centre de l'opéra Les Contes d'Hoffmann de Jacques Offenbach se trouve le poète E.T.A. Hoffmann, dont les nouvelles et les romans étaient extrêmement populaires à Paris au milieu du 19ème siècle. Sur quoi vous êtes-vous d'abord concentré lors de la préparation de ta mise en scène : sur le poète Hoffmann ou sur le compositeur Offenbach ?
L'opéra est très connu, je l'ai bien sûr souvent vu sur scène. Et j'aime depuis toujours l'auteur E.T.A. Hoffmann. Pour ma mise en scène, je me suis d'abord penché sur la forme de cet opéra : trois histoires encadrées par un prologue et un épilogue. Dans de nombreuses représentations, ce cadre ne m'a pas vraiment paru clair ; j'avais surtout l'impression de voir différentes histoires plus ou moins efficaces, mais insuffisamment reliées entre elles. C'est pourquoi j'ai ressenti le besoin de trouver pour ma mise en scène une solution formelle qui permette de ne pas se perdre dans les différents épisodes. Cette réflexion sur la forme s'est accompagnée d'une exploration de la genèse de l'œuvre. Il s'agit en effet d'un fragment, et le quatrième acte a longtemps été inconnu. À ce jour, cet acte Giulietta, laissé inachevé par Offenbach, soulève encore de nombreuses questions ; l'histoire ne semble pas aboutie. Cela frappe particulièrement lorsqu'on compare cet acte à l'acte Antonia qui le précède, qui est extrêmement fort et cohérent. Au début de mon travail sur cette pièce, mes réflexions portaient donc davantage sur la forme que sur le contenu.
Et pour vous, quel est le contenu de cette pièce ?
J'ai l'impression que des gens de théâtre très intelligents et doués pour les affaires se sont emparés d'un sujet populaire et en ont tiré des histoires, en tenant compte de considérations pragmatiques, à savoir les acteurs et actrices talentueux et populaires qui étaient disponibles à l'époque. L'objectif des auteurs était de remporter un succès en mettant en valeur ces nombreuses facettes différentes. Le personnage d'Hoffmann n'a jamais existé. On suppose qu'E.T.A. Hoffmann est en réalité le protagoniste de ces histoires, ce qui est bien sûr injuste envers ce grand poète et ses relations avec les femmes, qui n'étaient certes pas faciles, mais certainement pas telles qu'elles sont décrites dans cette pièce. Pour moi, Les Contes d'Hoffmann est avant tout un spectacle musical incroyablement génial, avec une palette extraordinaire de styles et d'émotions comme on n'en trouve nulle part ailleurs. Le plaisir réside dans les détails, dans les situations créées par Offenbach. Il s'agit de romantisme noir, de magie noire et de forces maléfiques ; c'est effrayant, mais cela peut aussi être très drôle. Il ne faut pas étouffer la diversité de cette œuvre par une approche trop philosophique.
Mais Les Contes d'Hoffmann n'est-il pas aussi un opéra sur les artistes ? Dans le prologue, la muse dit qu'elle veut détourner Hoffmann de ses aventures féminines afin qu'il puisse se consacrer entièrement à la poésie. Qui est cette muse pour vous ?
La muse se déguise dès le début en Nicklausse ; elle devient le compagnon masculin d'Hoffmann, c'est donc un personnage androgyne. Mais en fin de compte, c'est une sorte de déesse qui aime Hoffmann, tout comme Pallas Athéna aime Ulysse. Cependant, tel qu'il nous est présenté dans le prologue, Hoffmann est un gros buveur qui a cyniquement renoncé à la vie ; ce qui, là encore, ne rend pas tout à fait justice au Hoffmann historique, car s'il aimait certes le vin, il n'était sans doute pas aussi autodestructeur que le Hoffmann de l'opéra. C'est une belle trame narrative : un artiste qui n'a pas de chance avec les femmes, mais qui puise son inspiration dans son art. La muse souhaite désormais qu'il se consacre uniquement à son art. Cela crée une polarité entre l'art et l'amour, qui n'est toutefois pas vraiment exploitée. Les trois histoires individuelles sont certes motivées par cela, mais on n'a pas l'impression de repartir avec un message à la fin. En tant que metteur en scène, je dois donc trouver une solution. Et cela ne m'est apparu clairement qu'au cours des répétitions. Le chef d'orchestre Antonino Fogliani et moi-même avons constaté qu'il serait intéressant de reprendre à la fin cette relation complexe entre Hoffmann, la muse et la chanteuse Stella, qui est exposée dans le prologue. Nous avons imaginé ce qui se passerait si la relation entre Hoffmann et Stella avait plus de potentiel ; cela signifierait que l'artiste pourrait finalement concilier son amour et sa créativité. La contradiction formulée au début par la muse – je suis la muse, j'aime le poète Hoffmann, mais il aime Stella, qui l'empêche d'écrire, elle est donc ma rivale – serait ainsi résolue à la fin.
L'art ne peut donc pas naître sans expérience de la vie...
Oui, mais il ne faut pas confondre la vie d'un artiste avec son œuvre.
Parlons maintenant des trois femmes de la pièce. Chacune des trois histoires que Hoffmann raconte comme des souvenirs de sa vie traite d'une relation amoureuse qui a échoué : Dans l'acte Olympia, Hoffmann se rend compte qu'il est tombé amoureux d'une poupée ; dans l'acte Antonia, l'amante meurt en chantant à tue-tête ; et dans l'acte Giulietta, Hoffmann est trompé par une courtisane qui est de mèche avec le diable. Ces trois femmes sont-elles plus que des projections masculines ?
Elles correspondent à une image réductrice de la femme au 19ème siècle. La femme n'était pas vraiment prise au sérieux. L'homme contrôle tout, la femme doit se contenter de certains rôles, idéalement celui de femme au foyer et de mère, bien sûr. Il existe ensuite des projections qui s'écartent de ce modèle, comme l'artiste Antonia, profondément sensible, qui se perd dans son art et incarne ainsi le sacrifice féminin typique de l'opéra, qui nous bouleverse tant. Ou encore la femme fatale, la courtisane, qui est tout de même une femme indépendante, et la poupée, qui correspond à un fantasme érotique étrangement réduit. Soit trois clichés féminins qui apparaissent lorsque les femmes ne sont pas prises au sérieux par les hommes. De ce point de vue, il est d'ailleurs tout à fait juste qu'Hoffmann échoue avec ces trois femmes. Mais il y a aussi Stella, qui existe dans le présent et dont on dit qu'elle réunit ces trois femmes en une seule. Ce n'est pas forcément un compliment, si on le prend au pied de la lettre. Pour moi, cela signifie avant tout que Stella est une femme qui est à égalité avec Hoffmann. Il est significatif qu'elle soit une chanteuse indépendante de son mari et non une femme au foyer bourgeoise.
L'adversaire d'Hoffmann dans le monde réel est Lindorf, qui s'intéresse également à Stella. Dans les trois histoires racontées par Hoffmann, il apparaît sous différents rôles – la personnalité d'Hoffmann semble se désagréger de plus en plus, jusqu'à la perte de son reflet dans le miroir, tandis que son adversaire devient de plus en plus fort...
Pour moi, la relation entre Hoffmann et cet adversaire a quelque chose de Faust et Méphisto. C'est ce qui fait le lien entre les différentes parties de l'œuvre : les récits d'Hoffmann sont un voyage à travers ses souvenirs, déclenché et accompagné par ce personnage méphistophélique qui, sous différents noms – Coppélius, Docteur Miracle et Dapertutto –, intervient à plusieurs reprises dans les histoires et reste toujours reconnaissable, même déguisé. Mais les deux forces qui s'affrontent dans la lutte pour Hoffmann sont en réalité la muse et Méphisto – le bien contre le mal.
Et la force du bien finit par l'emporter ?
Je laisse le public se laisser surprendre...
On lit souvent à propos des Contes d'Hoffmann qu'Offenbach, après ses succès gigantesques dans le genre comique, aurait enfin réalisé son rêve d'écrire une œuvre sérieuse ; mais n'est-il pas plutôt vrai que cette pièce réunit en elle-même de nombreux styles et genres différents ?
Oui, absolument ! L'acte Olympia, en particulier, recèle un immense potentiel comique. Je dois avouer que ce n'est qu'en m'intéressant à cette pièce que j'ai pris conscience du génie d'Offenbach – un homme de théâtre qui maîtrisait avec brio tous les styles et tous les genres de son époque tout en conservant une signature très personnelle. Il était en outre doté d'une incroyable inventivité mélodique. C'est d'ailleurs tout le contraire d'un personnage comme Wagner, qui partait dans chacune de ses pièces d'une idée philosophique fondamentale pour ensuite construire ses personnages ; les opéras de Wagner étaient déjà parfaitement élaborés sur son bureau. Offenbach était tout autre : il ne s'engageait pas dans une conception globale, mais était avant tout attaché à l'expérience théâtrale sensuelle et a créé un théâtre incroyablement joyeux, qui est toujours le reflet de la vie et se nourrit également de contradictions. Magnifique !
Il est d'autant plus regrettable que le praticien du théâtre qu'était Offenbach n'ait pas eu la chance d'assister à la première de sa dernière œuvre. Il n'existe donc pas de version définitive de cette pièce, et chaque metteur en scène doit aujourd'hui créer sa propre version à partir des nombreuses variantes qui ont été transmises.
Oui, et on sent bien que le quatrième acte n'est pas vraiment terminé. Parfois, j'aimerais qu'Offenbach entre dans la salle et regarde ce que nous avons fait. J'espère qu'il aimerait...
Encore un mot sur notre distribution : vous avez décidé de confier les trois rôles féminins à trois chanteuses différentes.
Cela donne à chaque acte une couleur qui lui est propre. Même si, comme je l'ai dit, la pièce dit que les trois femmes sont différentes facettes d'une seule et même femme – Stella –, je trouve qu'on perd quelque chose en confiant les trois ou quatre rôles féminins à la même chanteuse.
Entretien réalisé par la dramaturge Beate Breidenbach. Traduit de l’allemand.
GALERIE










